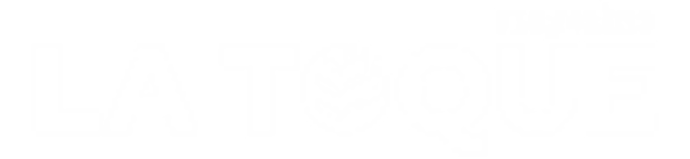Le café, c’est aussi une histoire d’odorat. En ce jour venteux de la fin du mois de janvier, les effluves compacts, à la fois doux et sucrés de la torréfaction sont perceptibles à plus d’un kilomètre de la brûlerie Anne Caron. Et plus l’on s’approche de Saclay, dans l’Essonne, où l’atelier de la maison est installé depuis 2019, plus elles s’intensifient. Anne Caron, Meilleur ouvrier de France (MOF) torréfaction, est à la tête de cette entreprise fondée par ses parents Sylvain et Chantal Caron en 1974. Quand elle n’a pas le nez dans le café – c’est notamment aux parfums qui se dégagent des grains torréfiés qu’elle sait quand il faut cesser de les cuire –, elle travaille à l’avenir, durable, de l’entreprise familiale, qu’elle incarne aujourd’hui jusque sur l’emballage des blends. Sacrée Meilleure torréfactrice de France en 2017, elle a obtenu le titre de Meilleur ouvrier de France en 2023. La torréfactrice cinquantenaire raconte son parcours, son art, et ne cache pas son immense joie d’avoir réussi l’examen centenaire, elle dont le métier n’est reconnu par le comité d’organisation d’Un des Meilleurs ouvriers de France que depuis 2018.

La Toque magazine (LTM) : Pourquoi avoir fait le choix de participer au concours de MOF ?
Anne Caron (AC) : J’adore les concours. Ils obligent à aller au maximum de ce que l’on peut faire. Comme je suis très curieuse, je pars un peu dans tous les sens, et ça me permet de me canaliser. Ce qui est intéressant, quel que soit le résultat, c’est la préparation, tout ce que l’on va acquérir comme connaissances. Après avoir passé un concours, on n’est plus le même. Si en plus on l’a, c’est génial ! Cela amène également à se structurer. À se demander : “Qu’est-ce que je suis, qu’est-ce que je veux être en tant que torréfacteur ? Est-ce que je veux être quelqu’un simplement qui grille du café ou ai-je un autre rôle ?” Moi, je considère que je suis un passeur entre l’agriculteur et le consommateur. Il se joue beaucoup en amont de la tasse, les choix que l’on fait sont déterminants.

LTM : Comment avez-vous accueilli la nouvelle de votre réussite ?
AC : Il y a de rares moments dans la vie où l’on ressent de la joie à l’état pur : celui-là en a été un. Franchement, j’ai été transportée sur un nuage pendant… Je pense que je ne suis pas encore redescendue (rires). On avait démarré un gros travail marketing un an avant pour aboutir à une nouvelle marque qui est Anne Caron [remplaçant l’ancienne dénomination Maison Caron, NDLR]. Et, concomitamment, il y a ce titre qui arrive : c’est comme si toutes les étoiles s’alignaient en même temps. J’ai eu une pensée pour mon père, un clin d’œil : “Ça, tu ne l’as pas fait, tu ne l’as pas eu [Sylvain Caron a été sacré Meilleur torréfacteur de France en 2011, NDLR]”. Quand je me suis inscrite au concours, je pensais qu’il était inabordable. J’avais échoué une première fois en 2018. Là, je faisais partie des douze finalistes, meilleurs ouvriers de France et du monde. Lorsque j’ai reçu le courrier me disant : “Vous êtes MOF”, j’ai tout de suite appelé un membre du jury pour lui demander : “Tu es sûr qu’ils ne se sont pas trompés, que j’ai bien été sélectionnée ?” Il m’a répondu : “Oui, Anne, et de loin”.
LTM : Que signifie pour vous le titre de MOF ?
AC : C’est une reconnaissance ultime. Par rapport à des marques industrielles qui se prévalent de tout, ce titre-là est indiscutable. Cela signifie que l’on ne peut pas questionner le fait que je veuille mettre de l’excellence dans mes cafés. En tant que femme, c’est souvent assez difficile de s’imposer. Je n’en ai pas eu besoin pour être reconnue mais Meilleur ouvrier de France, c’est la cerise sur le gâteau : cela apporte une légitimité bienvenue. Maintenant que cette étape est devenue incontestable, je peux passer à autre chose. Travailler plus sur l’empreinte carbone, par exemple.
LTM : Le bon café vient de loin…
AC : Pour obtenir un café de qualité, 80 % du travail s’effectue au niveau du pays producteur. Le torréfacteur sélectionne les meilleurs cafés, mais il s’intéresse aussi à tout ce qui se fait en amont, à comment on passe de la cerise [fruits du caféier, chaque cerise contient deux grains de café, NDLR] aux grains verts. Sélection des variétés, terroir, climat, récolte, avec les opérations amenant à séparer le fruit du grain, ce sont des étapes clés. Si les cerises sont trop ou pas assez mûres, si elles n’ont pas un bon taux de sucre, il n’y aura pas assez d’éléments pour que le café soit bon ; si une fermentation se développe au mauvais moment – la fermentation des grains diffère en fonction des process : c’est un peu la différence entre le chou et la choucroute –, ou s’il y a des moisissures, cela va induire de mauvais goûts, des maladies aussi, qui vont affecter la tasse. À l’inverse, si l’on réussit très bien ces étapes, on va maximiser le potentiel du café. Cela demande une connaissance des variétés de café, du terroir, des métiers agricoles, de la chimie…

LTM : Comment avez-vous appris votre métier ?
AC : J’ai eu une formation par frottement : j’ai appris à torréfier avec un torréfacteur. Lui savait ce qu’il fallait faire, mais ne savait pas l’expliquer scientifiquement. Moi j’ai une formation en biologique végétale – initialement je me destinais à la recherche –, du coup, j’ai écumé toute la littérature scientifique sur le sujet.
LTM : Comment décririez-vous votre travail ?
AC : La torréfaction, c’est en même temps de la création, parce qu’on touche le grain de café, on le transforme, et un métier ancré dans la terre. Au niveau agricole, les précurseurs des goûts, c’est la dégradation du sucre : pourquoi les cerises ont-elles plus ou moins de potentiel ? Quant à la torréfaction, c’est une cuisson, et la cuisson, c’est de la physique-chimie. En fonction de ses propriétés physiques, le grain est plus ou moins résistant à la chaleur. Quand elle pénètre dans le grain, cela provoque des réactions de cuisson qui sont les mêmes qu’en pâtisserie : la réaction de Maillard, celle de dégradation de Strecker. Et, comme en pâtisserie, quand ça commence à sentir bon, ça veut dire qu’il faut commencer à surveiller : la fin de la torréfaction se joue à quelques secondes. La différence de goût obtenue à ce moment-là dépend alors de la façon dont on a véhiculé la chaleur jusqu’au cœur du grain : on parle de courbe de cuisson. Il ne s’agit pas seulement de mettre du gaz, mais de jouer sur plusieurs paramètres : augmenter ou diminuer le gaz, la vitesse du tambour, l’airflow… Puis, il y a le moment où l’on sort les grains du brûleur, qui va leur donner une couleur de cuisson. Or, avec une couleur similaire, il est possible d’obtenir deux goûts complètement différents. Parce que, à un même stade de la torréfaction, vous avez cherché à développer la sucrosité du café et ralenti la chauffe, ou plutôt la vivacité du goût et accentué la chauffe.

LTM : Mais torréfacteur, ce n’est pas que bien sélectionner et cuire le grain de café.
AC : Si je respecte bien toutes ces étapes, j’obtiens une bonne torréfaction. Après, avec deux ingrédients – de l’eau et du café –, il faut faire un bon café, qui est une solubilisation, c’est-à-dire ce qui se délite de la matière pour entrer dans l’eau. Celle-ci dépend de plusieurs facteurs : la température de l’eau et le temps de contact avec le café. Plus on moud le café, plus on augmente la surface, donc le temps de contact avec l’eau. La courbe de solubilisation du café c’est, dans l’ordre : les sels, les acides – citriques puis maliques –, les sucres simples, complexes, et les molécules complexes, qui donnent de l’amertume. Si vous n’infusez pas assez, vous allez obtenir quelque chose de plat et d’acide ; si vous infusez trop, de l’amertume. Amertume qui dépend aussi de la variété du café et de la façon dont vous l’avez torréfié.
LTM : Le concours de MOF torréfaction n’a été créé que très récemment, pour quelle raison ?
AC : Le café faisait partie des produits oubliés. Il n’y a pas d’enseignement dédié en lycée hôtelier. Jusque dans les années 1960-1970 et l’arrivée de la grande distribution, c’était un savoir-faire lié à l’épicerie, généralement des petites épiceries de ville qui avaient un torréfacteur pour préparer le café qu’elles vendaient. Les plus âgés s’en souviennent. Les volumes de vente se sont progressivement déplacés vers la grande distribution. Le message du café n’était alors porté que par les industriels. Alors ce n’est pas pour ça qu’ils font un mauvais boulot, mais nous ne faisons pas tout à fait le même. Surtout, le produit était de plus en plus masqué. Avant, les gens le consommaient plutôt moulu, en brique sous vide, avec des cafetières traditionnelles. Puis ils sont passés aux capsules. Résultat : on ne touche pas le produit, on ne le voit pas, et on ne réalise plus qu’il s’agit avant tout d’une denrée agricole. Au-delà de cela, c’est aussi un produit gastronomique, un secteur qui a occulté le café pendant des années. Les restaurateurs en vendent mais ne s’y intéressent pas du tout.
LTM : Quand cela a-t-il changé ?
AC : Quand j’ai reçu le titre de Meilleur torréfacteur de France en 2017 [créé en 2010, NDLR], on commençait à parler du métier et du café de spécialité. Pendant le Covid, ça a explosé : ceux qui travaillaient buvaient leur café à la maison. Là, on choisit son café, on ne le subit pas. Ils l’ont envisagé différemment. Moi, je faisais partie d’un mouvement de torréfacteurs qui trouvaient anormal qu’il n’existe pas de concours de Meilleur ouvrier de France. Il ne peut pas y avoir des épreuves de cuisine, de pâtisserie, de chocolaterie et pas de torréfaction. Le café est l’une des denrées les plus consommées au monde ! Que cette culture du café ne percole pas dans l’univers de la gastronomie, ce n’était juste pas possible !

LTM : Il n’y a pas de femmes MOF en pâtisserie, boulanger ou chocolaterie, mais déjà deux en torréfaction, pourquoi, selon vous ?
AC : Les arts représentés à l’examen de Meilleur ouvrier de France sont des métiers de la main, plutôt masculins – les filles sont moins orientées en CAP. Mais l’engouement pour la torréfaction date d’une dizaine d’années, à un moment de la société où les femmes n’ont plus de barrières pour exercer n’importe quel métier. Donc, on n’hérite pas d’un passé masculin, ou dans certaines limites, et il y a beaucoup de torréfactrices. Traditionnellement, le métier était plutôt masculin parce que les sacs de café pèsent 60 kilos, mais la génération de professionnelles qui est la mienne trouve des solutions. J’étais meilleure torréfactrice il y a presque dix ans aussi, ça a peut-être initié quelque chose autour du fait que c’est possible pour une femme. En 2019, c’était d’ailleurs encore une femme, Mélanie Badets. Il y a aussi le fait que ces métiers qui ont du sens sont typiquement des métiers de reconversion. Or, quand on change de profession à 35 ou 40 ans, on peut avoir cette envie de devenir MOF qu’on n’aurait pas eu à 20 ans. L’examen de MOF, c’est la reconnaissance d’une carrière : moi, je suis torréfactrice depuis quinze ans. Il faut oser aussi. Peut-être que susciter l’envie chez les femmes de concourir, c’est le boulot du COET MOF [Comité d’organisation des expositions du travail et de l’examen Un des Meilleurs ouvriers de France, NDLR]. Même si, quand on a ce col bleu blanc rouge, on est ambassadeur du concours. Donc c’est peut-être à nous de leur dire : “Allez les filles !”

LTM : Le titre de MOF a un impact sur la notoriété de la marque, sur les ventes ?
AC : Le titre de MOF me permet de créer de la valeur pour le projet de développement durable que je mets en place : 50 % de mes cafés seront transportés à la voile en 2025. Je ne sais pas si j’aurais pu le faire sans, parce que ça engendre un surcoût qu’il faut faire comprendre et accepter aux consommateurs. Là, la recherche d’excellence concerne le produit mais aussi sa durabilité. Je pense qu’aujourd’hui un MOF ne peut pas ne pas avoir cette préoccupation.