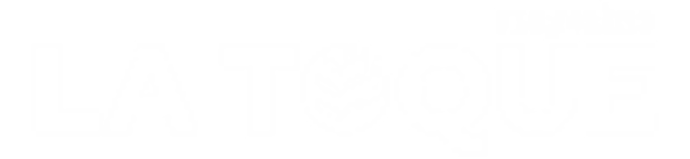La Toque magazine (LTM) : Parlez-nous du café…
Ludovic Loizon (LL) : Le grain de café est composé à 60 % de cellulose*, c’est un bout de bois ce grain. Avant d’être torréfié, il est très acide, aigre même, et plus on le brûle comme du charbon — plus on le torréfie —, plus on perd l’acide. En Italie, pour masquer ses défauts, on va le sur-cuire jusqu’à arriver à une forte carbonisation du grain : ce sont des cafés très forts, très costauds, dans lesquels tout l’acide a disparu. On n’y connaît que l’amer. En France aussi, nous avons tous reçu une éducation avec des cafés très amers, que l’on mélange avec du lait ou du sucre. Alors, quand l’on découvre des cafés de spécialité** torréfiés à point — il y a des nuances de cuisson dans la torréfaction, beaucoup plus que dans une viande : entre bleu et à point, nous on a 115 unités de coloration —, pour lesquels on est arrivés à ne pas brûler l’acidité, à ce qu’elle reste dans le goût : ça crée un point d’exclamation au niveau de la mémoire sensorielle. Ce qui choque le palais au début — et ce qui plaît désormais — c’est l’acide et le fruité, quelque chose de très rémanent, sans l’amertume qui dérange et demande de boire trois verres d’eau par-dessus. On garde les parfums ; ceux du thé noir et de bergamote du café d’origine Éthiopie, par exemple. Voilà ce que le consommateur découvre encore aujourd’hui.
LTM : Cafés de spécialité, à origine unique : s’agit-il d’une demande de clients devenus plus exigeants ou d’une offre devenue plus pointue ?
LL : L’offre a suscité la demande. L’essor des coffee shops, du barista, a permis de communiquer sur le fait qu’il pouvait exister des origines séparées pour le café, sur les termes café de spécialité. Mais le client lambda est encore très loin de demander des origines. De la même manière, il n’est pas monnaie courante de trouver du café filtre dans un établissement de restauration en France : il est encore assimilé au jus de chaussette à l’ancienne. Aujourd’hui, 100 % de ces établissements sont équipés d’une machine à expresso italienne, conçue pour faire du ristretto italien. C’est la raison pour laquelle lorsque l’on se rend dans un coffee shop digne de ce nom, dans lequel sont proposés des cafés filtre avec telle ou telle origine, c’est une révolution pour le palais. D’ailleurs, combien de cafés allongés sont-ils demandés en France par ceux qui n’aiment pas la force de l’expresso ? Le large american coffee, que l’on appelle café allongé, est une offre de café filtre en réalité. Alors, en coffee shop, il y a également des infusions à froid, des macérations ; pas uniquement la french press [cafetière à pistons, NDLR], des techniques de filtre classiques aussi… Mais tout une gamme d’accessoires aujourd’hui permettent une offre complémentaire à l’expresso. Et cela, de la même manière, ce n’est pas une demande des clients : plus c’est mis en avant, plus ça marche. La proposition crée l’intérêt.
LTM : On ne parle plus du petit café du matin, que l’on boit pour se réveiller. C’est plus gourmand.
LL : C’est plus gourmand, c’est plus riche, c’est plus aromatique. Ce qui fait aussi le succès de cette offre, c’est que l’on peut l’adapter à chaque individu. Avec passion, avec délicatesse, on amène à redécouvrir un produit, le café, considéré comme basique. D’ailleurs, l’offre commence à être à 360° autour de la restauration : le matin, le midi, l’après-midi pour le côté désaltérant et le soir pour le côté digeste. Je fais de l’événementiel, notamment dans le Sud, et on nous demande du café jusqu’à 23 heures-minuit : des expressos martini, des cocktails avec des liqueurs ou de la vodka dans lesquels on va intégrer un expresso. Un petit café frappé l’après-midi quand il fait chaud, ou infusé à froid [le cold brew, NDLR] — il y a des cafés infusés à froid pendant vingt-quatre heures avec des goûts complètement différents de ceux extraits avec de l’eau chaude — font désormais partie des offres désaltérantes ; même si l’on ne voit pas tous les jours du cold brew en boulangerie, ni même en coffee shops d’ailleurs : cela demande une grosse préparation, du soin, de la minutie.
LTM : Vous étiez au Paris Coffee Show début septembre, quelles sont les tendances et les nouveautés du secteur ?
LL : Les tendances aujourd’hui dans le secteur, c’est ce qui est naturel, un peu comme en gastronomie. Le côté santé, avec toute une gamme d’alternatives aux produits laitiers, notamment, qui connaissent une forte demande dans le coffee shop de base mais aussi dans les kiosques annexes — ce qu’on appelle le corner —, dont la boulangerie fait partie. Les certifications biologiques, les labels de commerce équitable ont également le vent en poupe parce que la traçabilité est recherchée par les consommateurs. Sans parler de tous les développements RSE [responsabilité sociétale des entreprises] d’établissements qui s’engagent vraiment, font des gestes pour l’environnement que ce soit au moment de l’importation des grains de café — transport en bateaux à voiles —, de sa réalisation — emballages biodégradables — ou de sa consommation. Donc je dirais que c’est une offre qui est s’est élargie au niveau de la qualité et de l’éthique. Le coffee pairing [accord du café, en anglais, l’art de marier cafés et aliments, NDLR] est aussi d’actualité, en pâtisserie notamment mais pas seulement, avec une connaissance des desserts qui "matchent" avec certaines origines de café.

LTM : Le coffee pairing, de quoi s’agit-il ?
LL : Le coffee pairing est une tendance très intéressante. Il y a une offre de pâtisseries, notamment, qui peut s’accorder au mieux avec les cafés. Si l’on prend des fèves d’Afrique — du Kenya, par exemple —, ce sont des origines très citronnées, qui se marient bien avec tout ce qui est cheesecake. De l’autre côté du monde, on a l’Indonésie, avec des cafés très boisés qui vont aller plus avec des desserts au cacao, au caramel, des fondants… C’est un peu la tendance même dans la gastronomie, avec des poissons accompagnés de sauces au café, plein de choses vraiment sympas. Alain Ducasse [chef cuisinier, NDLR] a d’ailleurs ouvert, il y a cinq ans, à Paris, un café-atelier de torréfaction-boutique [La Manufacture de café, dans le XIe arrondissement, NDLR], suivi d’une boutique [La Canopée, dans le Ier arrondissement, NDLR]. Mais la première, c’est Anne-Sophie Pic vers Lyon, il y a dix-douze ans. Elle travaillait avec Café Mokxa et proposait du café de spécialité en fin de repas, avec le service traditionnel.
LTM : Quelle offre de café peut-on proposer en boulangerie ? Comment se lancer ?
LL : Il y a deux créneaux aujourd’hui en boulangerie traditionnelle. D’abord, le boulanger qui vend du café pour s’aligner sur la concurrence. Il va aller au plus simple, avec une machine automatique ou à dosettes et une offre élargie : options sirop, lait, macchiato, etc. Cela ne lui demandera pas de compétences particulières parce que les fractions vont se faire toutes seules ; il aura juste à appuyer sur une touche. Le boulanger un petit plus artisanal va travailler avec un moulin à café traditionnel, une machine à percolation italienne, et là, ça va lui demander un savoir-faire. Il faut une semaine pour comprendre les bases. Une première formation — apprendre à régler un moulin à café, à faire une belle mousse de lait pour cappuccino et à entretenir la machine, vraiment le b.a.-ba. — peut même se faire en trois jours. Nous formons d’ailleurs de plus en plus de coffee corners en boulangerie. Sinon, les artisans n’ayant pas le temps, ils utilisent beaucoup le système des dosettes. D'ailleurs, l’offre en boulangerie, majoritairement, ce n’est ni du café traditionnel ni du café de spécialité, mais un autre café, plus industriel qui intervient en complément du snacking. Pour tenir le client jusqu’à la finalité, c’est-à-dire le café après le déjeuner, et booster le chiffre d’affaires, le café doit aller vite. L’ambiance y est à l’opposé de celle du coffee shop, dans lequel le client vient pour se poser, déguster des produits d’exception et avoir la possibilité, entre guillemets, de les analyser.
LTM : Des coffee shops qui ont du succès en ce moment.
LL : Depuis deux ans, un coffee shop ouvre quasiment tous les mois à Paris. Je fais beaucoup de formations pour des gens en reconversion. Ils sont tombés amoureux du produit, l’ont redécouvert et ont eu envie de le développer pour le partager avec leurs clients. Ils se font plaisir en faisant plaisir. Ceci dit, on ne parle pas de ceux qui ferment. Certains pensent gagner des millions d’euros la première année au prétexte que le café, “C’est la meilleure marge du bar”. Oui, mais 2 € par 2 €, c’est comme pour un boulanger avec ses baguettes, il faut en vendre pour être rentable. Celui qui est installé à côté d’une université américaine et qui fait de la vente à emporter peut ne proposer que du café, sinon, cela ne suffit pas. C’est la raison pour laquelle tous les établissements ont une offre salée, afin de rehausser le ticket moyen.

LTM : Quel est le rôle du barista et pourquoi fait-on appel à lui en boulangerie-pâtisserie-coffee shop ?
LL : Un barista, comme un sommelier avec la vinification, est censé connaître les process de A à Z, ne serait-ce que pour pouvoir vendre le café au client. Parce que, s’il y a qualité et qualité, il y a aussi prix et prix : comment justifier qu’un café lavé du Nicaragua coûte quatre fois plus cher que le petit café brésilien d’une grande marque : il faut pouvoir l’argumenter. Le barista relie tous les chaînons qualité depuis le pays producteur : la variété botanique, la récolte ; le soin mis au process, à l’importation ; la torréfaction, et l’extraction par ses soins. Il préserve la bonne qualité du café. Nous sommes souvent contactés par les artisans pour tracer les grandes lignes de l’offre. Nous leur expliquons comment marche la torréfaction, comment ils peuvent s’en sortir pour équilibrer les goûts : c’est un jeu d’allers-retours jusqu’à ce qu’ils trouvent leur segment. Nous intervenons aussi dans un second temps en dégustant sur place. Attention, je vous parle des profils d’artisans les plus attentionnés, les plus passionnés…
LTM : Justement, quelle est la tendance en matière d’origine pour les passionnés ?
LL : Sur une carte à café, vous trouvez toujours un peu de café du Brésil, parce que c’est le premier producteur et que quand il y a un mélange il y en a toujours un peu. Mais aujourd’hui, la tendance est au mono-origine. En Amérique centrale, il y a un gros essor de cafés de spécialité, des cafés aux goûts à tendance acide, liée à l’altitude. En Afrique un peu aussi, en Éthiopie ou au Kenya, mais c’est surtout l’Amérique centrale qui se développe beaucoup : le Costa Rica, l’Équateur, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, tous ces pays sont vraiment très forts. À l’autre extrémité, le continent asiatique — la Birmanie, le Vietnam — se met à produire de l’arabica et émerge un peu en termes de qualité. Il y a des origines – Sumatra, en Indonésie, par exemple – qui commencent à être super qualitatives. De plus en plus de soin est porté aux productions là-bas. Avant, il n’y avait que du robusta : on en met pour déguster la caféine et donner du corps mais c’est amer, très brut de décoffrage. Aujourd’hui, il y a de plus en plus d’arabica, le grain de café qui donne le plus de parfums, de douceur, de sweet.
* Ou stuctures fibreuses apparentées, comme les polyholosides, la lignine ou les pectines (Source).
** Cafés ayant obtenu un minimum de 80 points sur 100 sur une grille de notation Specialty Coffee Association. Au-delà de 85 sur 100 on parle de grand cru.