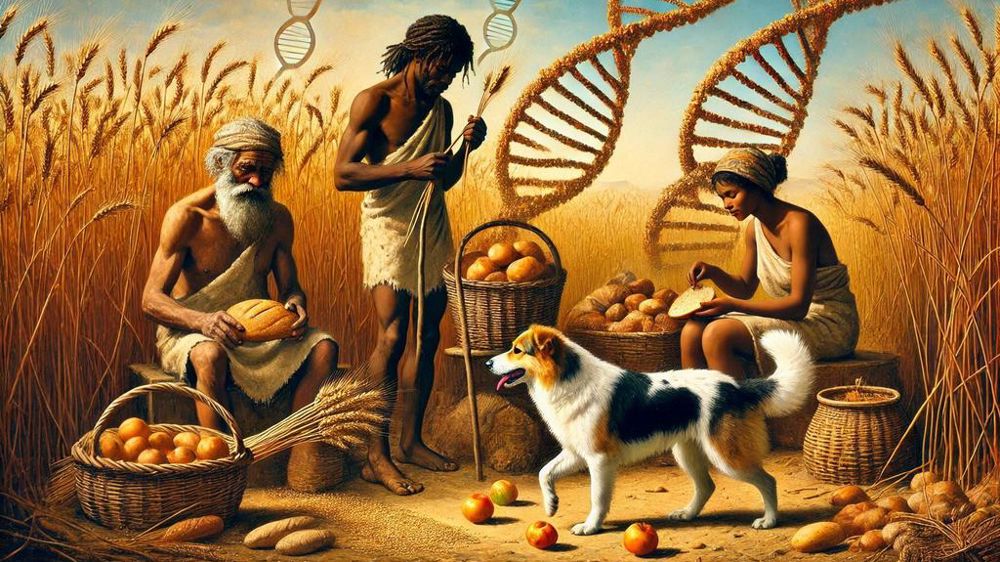L’Homme a commencé à cuisiner il y a un million et demi d’années, avant même l’apparition de l’Homo sapiens, rapporte Jonathan Silvertown, professeur à l’Institut de biologie évolutive de l’Université d’Édimbourg dans son livre Un Dîner avec Darwin : Des cavernes aux cuisines, l’évolution de nos assiettes*. La cuisine est une invention très ancienne, « qui a précédé nos gènes », sachant que l’homme dit moderne est apparu postérieurement, il y a environ 300 000 ans. Le fait de cuisiner est donc une habitude culturelle avec laquelle notre espèce a “co-évolué” depuis toujours.
D’un régime végétarien, il semble que nous sommes petit à petit passés à une diète plus carnivore. La cuisson ou la fermentation des aliments ont aussi permis d’accroître l’éventail des ingrédients comestibles pour l’Homme et de prédigérer les aliments. Ce faisant, son intestin s’est rétréci. En accroissant la valeur énergétique de l’alimentation, le cerveau s’est agrandi. Un cerveau humain dépense aujourd’hui au repos 20 % de l’énergie du corps alors qu’il représente 2 % de la masse corporelle. Puis, l’espèce humaine a sélectionné le blé, et celui-ci a de son côté “domestiqué” l’être humain dans ses gènes et dans sa culture en 10 000 ans d’agriculture et 20 000 ans de consommation de céréales sauvages.
Le blé blanchit la peau
L’espèce humaine Sapiens, sortie de son berceau africain, aurait conservé sa couleur de peau foncée jusqu’à ce qu’elle devienne agricultrice. Cette invention, qui s’est accompagnée de multiples avantages, a eu ses effets secondaires. Sous les latitudes tempérées les moins ensoleillées, elle aurait causé des carences en vitamine D, du fait de l’absence de cette dernière dans les denrées agricoles.
Les individus à la peau plus claire se seraient alors trouvés avantagés génétiquement, car celle-ci facilite la synthèse de vitamine D par le corps sous l’action des ultraviolets à des seuils d’ensoleillement inférieurs. « La sélection d’une couleur de peau plus claire en Europe s’est certainement produite lors du passage à une alimentation moins riche en vitamine D, au néolithique, que les préhistoriens situent entre - 6 000 et - 3 000 avant JC en Europe », confirme l’anthropologue et généticienne française Évelyne Heyer dans l’article “Gènes, culture et évolution : nouvel éclairage sur l’aventure humaine”**, paru dans la revue du Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
Cette théorie est corroborée par l’analyse de l’ADN ancien. Des échantillons attestent en effet que les premiers hommes modernes ayant colonisé le Royaume-Uni avaient la peau foncée et les yeux clairs. Dans les régions plus ensoleillées du globe, la culture du blé n’aurait pas eu ce même effet de blanchissement car l’ensoleillement était suffisant pour la synthèse de la vitamine D dans l’organisme. Cependant, sous les climats tempérés, il est conseillé aux personnes à la couleur de peau plus foncée de se supplémenter en vitamine D en hiver et, pour les nourrissons, les prescriptions quotidiennes de gouttes de vitamine D sont généralement plus dosées.
Un arsenal enzymatique
Moins visible, mais mieux démontrée scientifiquement, est l’adaptation des gènes à la consommation de l’amidon contenu dans le blé et les autres céréales cultivées. Un nutriment qui était peu consommé dans le mode de vie chasseur-cueilleur.
La révolution néolithique semble avoir eu un impact chez les populations grandes consommatrices d’amidon. Aujourd’hui, le nombre de copies du gène codant pour l’enzyme salivaire alpha-amylase varie de deux à quinze au sein des populations humaines, avec un plus grand nombre de copies chez les populations traditionnellement agricoles. « Le nombre de copies pour ce gène pourrait constituer une adaptation évolutive à un régime riche en amidon », suppose le professeur d’écologie évolutive Jonathan Silvertown. Il émet l'hypothèse que ces enzymes salivaires ont pour rôle de commander indirectement la libération d’insuline afin d’éviter une trop forte concentration de glucose dans le sang : « L’alpha-amylase a pour fonction de libérer le glucose issu de l’amidon dans la bouche, de sorte à envoyer une alerte préventive via des récepteurs gustatifs pour annoncer qu’une grande quantité d’amidon est en route vers l’estomac. L’insuline peut alors être libérée par anticipation et prévenir ainsi une glycémie élevée dangereuse », explique-t-il.

D’autres travaux portant sur la résistance à l’insuline montrent que les populations au passé agricole sont moins sensibles au diabète de type 2 — lié à un régime alimentaire riche en sucre et en amidon —, comparativement à des populations dont le passé est majoritairement dominé par des pratiques de chasse et de cueillette. En parallèle, selon ses habitudes agricoles et culturelles, l’Homme s’est plus ou moins bien adapté à la consommation d’alcool et de produits laitiers, mais de façon inégale parmi les populations, comme le montrent les données d’épidémiologie de l’intolérance à l’alcool ou au lactose, corroborées par les données de la génétique des populations.
Régime granivore
Au cours des derniers millénaires, l’espèce humaine — devenue en partie granivore du fait de sa consommation de blé — a dû s’adapter à cet aliment au départ toxique, du moins à l’état sauvage. Dans le schéma de l’évolution, la céréale n’était pas au départ destinée à être consommée par l’Homme.
« Il faut imaginer ce que c’est qu’un grain de blé sauvage, perché au bout d’une tige. Les pauvres graines sont sans défense, décrit l’astrophysicien français François Roddier dans son ouvrage Le Pain, le levain et les gènes — Un essai sur l’évolution. Elles ne survivent que grâce aux toxines qu’elles contiennent [les lectines, l’alpha-gliadine ; et les inhibiteurs d’enzyme, telles les phytates, NDLR]. Les inhibiteurs d’enzymes bloquent aussi les enzymes de notre système digestif : ils rendent les graines et la farine indigestes. Ils sont là pour empêcher la graine de germer tant que les conditions ne sont pas favorables. Ce sont aussi eux qui lui permettent de se conserver si longtemps. Il y a d’ailleurs un éternel dilemme entre la valeur nutritive d’un produit et sa conservation de nos jours. Certains animaux, comme les oiseaux, ont évolué pour digérer ces toxines. En revanche, les ossements des premiers agriculteurs montrent qu’ils étaient plus petits que les individus du paléolithique et qu’ils vivaient encore moins vieux. Ils étaient fréquemment atteints de maladies infectieuses ou d’anémie. La plupart souffraient de rachitisme, d’ostéomalacie ou d’ostéoporose, manquaient de fer et de calcium et avaient de nombreuses caries dentaires. »
François Roddier, met en évidence que l’Homme s’est adapté génétiquement à ces « maladies de civilisation agricole » en faisant référence aux travaux du généticien Luigi Luca Cavalli-Sforza, fondateur de la géographie génétique. « Les gènes ont d’autant plus évolué que l’agriculture est apparue plus tôt, tranche-t-il. On sait aussi que la maladie cœliaque est particulièrement répandue en Scandinavie et en Irlande. Ce sont bien des pays où l’agriculture est apparue tardivement, c’est-à-dire des pays où les gènes ont eu moins de temps pour évoluer. »
Aux origines potentielles de la maladie cœliaque
En parallèle, l’évolution a évidemment été culturelle pour éliminer l’effet des toxines, avec l’adoption de la cuisson, de la germination des grains et de la fermentation par le levain qui les dégrade. Mais certaines de ces cultures ont été laissées de côté, et des individus continuent à être mal adaptés.
Des maladies jugées incurables peuvent résulter du fait que l’alimentation n’est pas adaptée à la génétique de la personne jugeait ainsi François Roddier. Atteint lui-même de la maladie cœliaque, l’astrophysicien français mort en 2023 à 86 ans, assurait qu’il s’était “guéri” lui-même d’une partie des symptômes (mais pas des problèmes osseux, irréversibles) en consommant son propre pain au levain.
Il a développé également une théorie selon laquelle toute la gloire de la civilisation égyptienne repose sur le levain. « Sachant que le levain permet d’éviter les conséquences de la maladie cœliaque, on peut penser que les Égyptiens [qui ont selon lui inventé le pain au levain, NDLR] n’en souffraient plus. Ils sont donc devenus plus grands et forts. Et pour montrer leur force physique au monde, ils ont construit les pyramides. La forme de celles-ci rappelle l’empilement dans le four des moules à l’intérieur desquels ils cuisaient leurs pains, ose François Roddier. Les villes de Rome antique et de la Grèce ainsi que les pyramides d’Égypte ont été construites grâce au pain tout autant qu’elles l’ont été grâce aux pierres, les recherches archéologiques nous ont fourni des renseignements très précis », avance-t-il.
L'homme et le blé, une destinée commune
Tandis que l’être humain s’est adapté à la consommation de blé et de céréales, il a aussi façonné les céréales pour les adapter à ses besoins. Il s’est, sans le savoir, appuyé sur l’extraordinaire diversité et plasticité du génome géant du blé, tétraploïde, cinq fois plus grand que celui des humains. Il s’en est servi pour adapter la culture, améliorer les rendements, le décorticage, la conservation, la mouture, le goût…
« Tout comme la bonne cuisine, l’évolution est une affaire de potentiel des ingrédients, tranche Jonathan Silvertown. Ces faits sont écartés par ceux qui prétendent que notre évolution nous dicte de limiter notre alimentation en fonction de quelques notions fantaisistes sur notre régime paléolithique. Certes, notre histoire évolutive a façonné nos capacités alimentaires mais elle les a étendues plutôt que limitées. En fait, il existe de nombreuses façons de parvenir à une alimentation saine et équilibrée. »
* Dans sa démonstration, il s’appuie sur des traces découvertes d’ossements animaux brûlés à cette période présentant des traces de dépeçage.