La RSE s’enracine dans un demi-siècle d’histoire et prend aujourd’hui les atours d’une véritable culture de société. Depuis les années 1970, la protection de la planète n’a cessé d’agiter les sommets internationaux. Mais ce n’est qu’en 1992, au Sommet de la Terre à Rio, que l’Organisation des nations unies (ONU) invite clairement États, collectivités et les organisations à s’engager dans un développement « durable » prenant en compte le progrès économique, social et écologique. En 2012, lors d’un nouveau Sommet de la Terre à Rio, l’ONU formalise les célèbres « Objectifs de développement durable », qui représentent encore aujourd’hui des points de repère concrets. Avec les catastrophes écologiques qui ont marqué les esprits depuis les années 1970 (Seveso en 1976, Amoco Cadiz en 1978, Bhopal en 1984, Tchernobyl en 1986, Erika en 1999, AZF en 2001…), les dirigeants des grandes entreprises comprennent peu à peu que la rentabilité économique n’est pas le seul moteur de développement et que leur activité, pour être respectée et acceptée par la population, doit se fondre dans un territoire, une culture, un paysage, un écosystème…
Outil d’intégration sociale
La responsabilité sociale des entreprises (RSE), qui correspond à la traduction des principes du développement durable à l’échelle de l’entreprise, s’impose lentement mais sûrement comme un outil d’intégration sociale et environnementale. Une organisation devient responsable quand elle rend compte de ses activités à ses parties prenantes (salariés, clients, partenaires, fournisseurs, voisinage…) et quand elle prévient les risques et en assume les conséquences (sanitaires, écologiques, économiques, sociales…). Même si les évolutions législatives et les tendances du marché ont très largement incité les entreprises à s’aligner sur ces principes, certaines ont fait le choix d’aller plus loin en mettant en place une véritable démarche RSE.
Le succès des farines certifiées en boulangerie artisanale favorise la percée des filières agricoles durables (ici farine Girardeau).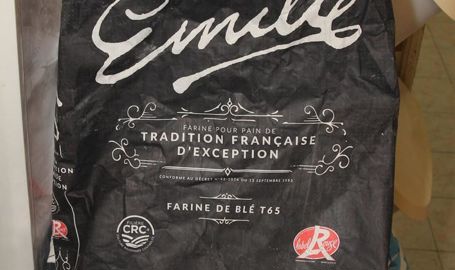
Chaîne de valeurs
Pour progresser, chaque entreprise est invitée à établir un autodiagnostic et à formaliser un plan d’amélioration continue, selon ses priorités et les outils qu’elle définit elle-même (tels que les normes Iso 26000 ou 14001 ou les référentiels Ecovadis ou Sedex). Un plan RSE sans objectifs clairs, précis et mesurables tombe dans le « greenwashing » (technique marketing de « verdissage »). En filière blé-farine-pain, les défis sont nombreux et complexes car ils concernent une chaîne de valeurs (du blé au pain) dont la responsabilité est partagée entre des entreprises de culture et de profil fort différents (agriculteurs, coopératives-négoces, meuniers, boulangers). Entre les exigences des consommateurs d’un côté (dont les attentes sont de plus en plus « hors sol ») et celles des producteurs de céréales (qui défendent un modèle agricole productif et rentable), trouver un consensus relève d’un véritable bras de fer, d’autant que, sur le plan écologique ou sanitaire, quand on tire dans un sens, d’autres problématiques apparaissent. Par exemple, choisir un mode de stockage des blés sans insecticides pose des défis techniques pour lutter contre les nuisibles, à la fois coûteux pour l’entreprise (investissement, énergie) et pesant sur le bilan carbone (la réfrigération et le séchage des blés en silos s’imposent). Tout n’est jamais tout noir ou tout blanc et encore moins tout rose. Mais, au gré des évolutions technologiques et des connaissances agro-écologiques, il y a toujours moyen de progresser pas à pas, en investissant avec cohérence sur le long terme. La transition écologique constitue le principe de fond d’un véritable plan RSE. Si celui-ci n’est qu’une belle communication, alors l’entreprise rate son rendez-vous avec l’avenir.
Les blés anciens peuvent-ils résoudre les grands défis de société ?

Structures collectives et collaboratives
Au cœur de la RSE, la question des filières blés est centrale. Mais la réponse (technique et marketing) est transversale. C’est pourquoi les grandes batailles se gagnent par la volonté de structures collectives et collaboratives. Le succès des cahiers des charges écoresponsables en France est un bel exemple (voir plus bas). C’est le cas par exemple de la filière CRC (portée par un groupement d’intérêt économique regroupant 34 coopératives-négoces et 56 meuniers), de la Charte de production agricole française (portée par les instituts Hypérion et Arvalis et un grand nombre de coopératives, négociants, meuniers…) ou encore de la démarche Blé écoresponsable des Moulins Viron, dont les défis techniques ont été résolus par une concertation étroite entre plusieurs acteurs issus d’univers très différents. Bien sûr, c’est encore mieux lorsque ces cahiers des charges montent en exigence dans le temps, commec’est le cas du CRC). Autre dossier fondamental : la lutte contre le réchauffement climatique. Les meuniers ont fait (et font encore) des efforts considérables pour réduire leur empreinte carbone en réduisant leur consommation d’énergie ou en faisant appel aux sources renouvelables. La tendance aux circuits courts se traduit par la décentralisation de leur outil industriel au cœur des bassins céréaliers et la réduction des distances parcourues (approvisionnement en blés et distribution de farines). D’anciens petits moulins en fin de vie sont rachetés et remis en service. Les artisans meuniers et les entreprises familiales retrouvent une certaine vigueur, notamment via l’appui de réseaux (comme Petits Moulins de France).
Trois piliers du développement durable
Pour l’avenir, la minimisation des intrants (fertilisants azotés, eau, herbicides, fongicides) reste certainement le plus gros défi à relever. La mise au point de variétés de blés et de méthodes culturales permettant de retrouver une indépendance vis-à-vis de l’industrie chimique est complexe. Globalement, plus on diminue les intrants, plus on baisse le rendement à l’hectare et la quantité/qualité des protéines. La farine devient plus difficile à panifier. Les pains sont plus denses et compacts, loin du canon de la « tradition française ». L’artisan boulanger et le consommateur français sont-ils prêts à se séparer de ce produit emblématique ? Les techniques boulangères peuvent-elles suppléer le manque de protéines ? Les essais sur les variétés anciennes (souvent des blés populations ou des mélanges) et les créations variétales pour l’agriculture biologique et biodynamique sont des recherches prometteuses. En milieu rural, le succès des paysans-meuniers-boulangers, grands utilisateurs de variétés bas intrants, fait aussi réfléchir. Leur organisation (circuits courts) et leurs pratiques agricoles (bio, blés de pays) sont assurément les plus vertueuses qui soient sur les trois piliers du développement durable. Ce modèle semble rentable car la vente directe sans intermédiaire et les économies sur les intrants chimiques compensent les faibles rendements en champs. Mais est-il adaptable à une plus grande échelle ? Et si le modèle le plus durable se trouvait dans une certaine écodiversité des « Business Models » ?
Dans les concepts de développement durable, l’agriculteur doit pouvoir vivre dignement de son travail.

Les grands défis de la RSE en filière blé-farine-pain
Pilier économique/marketing
Réduction de la consommation d’intrants chimiques, réduction de la consommation énergétique, rémunération équitable des acteurs, prix d’achat du blé garantis sur plusieurs années, positionnement qualité/prix cohérent avec les attentes du marché, respect des attentes de qualité et du savoir-faire artisanal (boulangers), respect des attentes de goût, de santé et de sécurité (consommateurs), alimentation sans résidus de pesticides et additifs de synthèse, certifications industrielles (qualité, sécurité, environnement, RSE), lutte contre les nuisibles en post-récolte (insectes, rongeurs, moisissures), qualité/sécurité du stockage des blés (stockeurs, fermes).
Pilier social/sociétal
Approvisionnement et distribution locale (circuits courts), pratiques sociales équitables (rémunération à compétence égale), valorisation des métiers et du savoir-faire artisanal (boulangerie, meunerie), développement des compétences, progression salariale, transmission et apprentissage, sécurité et bien-être au travail, politique d’emploi local, développement de partenariats locaux, établissement de liens de confiance avec les salariés et prestataires, préservation du patrimoine industriel, communication responsable (transparence, réassurance), soutien à la vitalité économique/sociale des territoires ruraux…
Pilier écologique/sanitaire
Minimisation des intrants chimiques (pesticides, régulateurs, engrais), préservation des ressources en eau (nappes, rivières), alternatives agro-écologiques (couverts, rotations, bio-contrôles), lutte contre la pollution agricole (résidus de pesticides, nitrates, cuivre…), lutte contre le réchauffement climatique (dioxyde de carbone, gaz à effet de serre), logistique et stockage bas carbone, énergie verte et autoproduction, préservation de la biodiversité autochtone (faune et flore), sélection de variétés modernes agro-écologiques (bas intrants), valorisation de la biodiversité cultivée (variétés anciennes, locales, paysannes), stockage sans insecticides, contrats blés labellisés/certifiés et contrôlés, analyses toxicologiques (pesticides, métaux lourds, mycotoxines), traçabilité, gestion des effluents, lutte contre le gaspillage, recyclage des déchets, emballages recyclés/recyclables.
Le stockage des blés sans insecticides est une avancée majeure en meunerie.
Quels sont les filières blés responsables* ?
> Agriculture biologique (AB, label officiel Inao).
> Agri-Éthique France (certification privée).
> Bio-équitable en France (certification privée).
> Biopartenaire (certification privée).
> Charte de production agricole française (CPAF, norme Afnor).
> Culture raisonnée contrôlée (CRC, certification officielle du ministère de l’Agriculture).
> Demeter (certification privée).
> Haute Valeur environnementale (HVE, certification officielle du ministère de l’Agriculture).
> Label Rouge (label officiel Inao).
> Nature et Progrès (certification privée).
*Certifiées par un organisme tiers indépendant.
Les plans RSE et engagements responsables des meuniers*
> Le plan RSE À table et les filières certifiées des Grands Moulins de Paris.
> Le plan RSE We Do Fair et les filières Semons du sens, des Moulins Soufflet.
> Le plan RSE Présence durable et les filières certifiées du groupement Festival des Pains.
> La filière Blé écoresponsable et le programme Moisson d’avenir des Moulins Viron.
> La démarche Filière qualité Banette et la filière CPAF de la maison Banette.
> La démarche Engagement qualité Bourgeois et les filières certifiées des Moulins Bourgeois.
> Les filières certifiées CRC, AB et Agri-Éthique France des Moulins Girardeau.
> Les filières certifiées CRC et LR des Moulins Foricher.
> Les filières certifiées LR et AB des Moulins Secrets d’artisans.
> L’organisation et la défense des artisans meuniers des Petits Moulins de France.
* Liste non exhaustive.




