La problématique était connue : deux études de Santé publique France (SPF), l’Étude nationale nutrition santé en 2006 et Esteban en 2014-2016, ont fait état de teneurs en cadmium inquiétantes au sein de la population française. La seconde évoquait “une explosion de la contamination des jeunes enfants […] en rapport avec leur alimentation — en particulier les céréales, pains et dérivés et les pommes de terre et apparentés”. En janvier dernier, c’est un reportage de Zone interdite sur M6* qui en a remis une couche. Début juin, enfin, les unions régionales de professionnels de santé-médecins libéraux (URPS) se sont inquiétées, dans un courrier envoyé au Premier ministre, de la hausse “spectaculaire” du nombre de cancers du pancréas en France, qui selon elles pourrait être corrélée à celle de l’imprégnation en cadmium de la population.
Un métal lourd cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction
Les chiffres sont en effet inquiétants. En 2006, près de la moitié des Français dépassaient la valeur toxicologique de référence (VTR) fixée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), dont 18 % des enfants. Par ailleurs, un tiers de ceux de moins de 3 ans dépassaient déjà cette VTR.
“Reconnu cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction, le cadmium entraîne chez l’être humain des atteintes rénales et une fragilité osseuse lors d’une exposition prolongée”, détaille l’Anses. Sa demi-vie dans l’organisme (temps nécessaire pour que la moitié de ses atomes se désintègrent naturellement) est de vingt ans.
Mais les discours à son sujet sont souvent incomplets ou trop shématiques. Au micro de La Toque, Laure Verdeau, directrice de l’Agence bio évoquait, par exemple, le fait que sans engrais, il n’y avait pas de cadmium**. Pourtant, comme l’explique Thibault Sterckeman, les engrais phosphatés, qui en contiennent, sont pour certains autorisés en agriculture biologique et le métal lourd est de toute façon déjà présent à des niveaux variables dans tous les sols français. Pour vous aider à y voir plus clair, l’ingénieur de recherche à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) a répondu aux questions de La Toque.
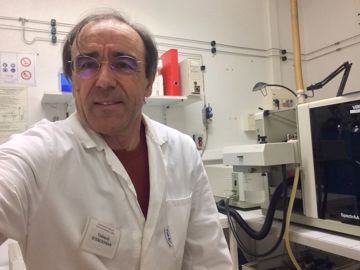
La Toque magazine (LTM) : Pourquoi y a-t-il du cadmium dans les sols ?
Thibault Sterckeman (TS) : Le problème, c’est d’abord le stock historique de cadmium. Celui présent dans les sols cultivés français est en moyenne à parts égales d’origine naturelle et anthropique [lié aux activités humaines, NDLR]. Mais cette proportion est très variable. Dans certains secteurs, comme le Nord-Pas-de-Calais, c’est plus lié à la pollution industrielle. Dans d’autres, comme le Jura, Les Charentes, certains endroits de Bourgogne ou du bassin parisien — dont les sols sont formés sur des roches calcaires naturellement enrichies en cadmium —, la part naturelle du métal peut représenter 75-80 % du total, voire davantage. Celui d’origine anthropique, lui, provient de la pollution atmosphérique — rejets de l’industrie, des combustions urbaines, des transports... — qui retombe de manière diffuse sur les sols. Depuis les années 1970-1980, cette pollution a beaucoup diminué. Il y a aussi les apports agricoles : les fumiers, les composts, les lisiers, les boues de station d’épuration… Et les fameux engrais phosphatés, fabriqués à partir de minerais de phosphate, eux-mêmes naturellement enrichis en cadmium. Actuellement, ils sont la principale source d’entrée de cadmium dans les sols : de 60 à 70 % des entrées en France d’après les études dont on dispose.

LTM : Pourquoi y a-t-il du cadmium dans les engrais phosphatés ?
TS : Le cadmium est un métal lourd présent naturellement dans le phosphate, qui est une roche produite par des processus géologiques, géochimiques anciens et de longue durée. Selon le gisement, c’est-à-dire l’endroit de l’écorce terrestre où la roche s’est formée, les roches phosphatées sont plus ou moins riches en phosphore et en éléments-traces, dont fait partie le cadmium. Les gisements du Nord de l’Europe — en Finlande, en Russie, par exemple — en sont moins riches que ceux que l’on utilise actuellement : en Afrique du Nord — Maroc, Tunisie — et en Afrique de l’Ouest. Comme c’est un élément-trace, on le mesure en milligramme par kilo, en partie par million. Or, c’est très difficile d’enlever des traces dans de la roche. Je ne suis pas sûr qu’on sache le faire actuellement à l’échelle industrielle et à un coût acceptable [le fabricant d’engrais phosphatés marocain semi-publique OCP Nutricrops, qui aurait investi dans des procédés de décadmiumisation, a opportunément annoncé il y a quelques jours avoir décroché la certification européenne Low Cadmium Labelled pour sa production à destination de l’Union Européenne, allant au-delà des exigences réglementaires communautaires actuelles, avec 20 mg/kg de pentoxyde de phosphore, NDLR].
LTM : Comment le cadmium passe-t-il dans les plantes ?
TS : Le lien n’est pas direct entre le cadmium de l’engrais et celui retrouvé dans la plante cultivée : le cadmium passe toujours par le sol, sorte de garde-manger dont on entretient les réserves. On apporte un engrais phosphaté sous forme de granulés. Le cadmium et le phosphore se dissolvent dans l’eau du sol, se collent sur les particules de sol — argile, oxydes de fer, humus — et restent là. Ils y sont en équilibre, avec une petite concentration dans la solution du sol, dans laquelle la racine va puiser pour absorber les éléments pour se nourrir : le phosphore, dont elle a besoin ; mais aussi, par inadvertance, le cadmium, qui est inessentiel. Dans le sol français, il est en moyenne présent à hauteur de 0,32 mg/kg de terre, alors que dans le grain de blé on le retrouve en moyenne à hauteur de 0,03 mg/kg : la plante agit comme un filtre.
Lire : Sélection variétale du blé : un idéal à revoir
LTM : Pourquoi les produits de boulangerie sont-ils pointés du doigt par les études ?
TS : Les plantes accumulent plus ou moins le cadmium selon l’espèce ou la variété. C’est génétiquement déterminé. Le blé est dans la moyenne en la matière, mais on en mange beaucoup : c’est pour ça qu’il apparaît dans les enquêtes. Le blé dur a d’ailleurs tendance à en accumuler davantage que le blé tendre, panifiable. Le chocolat, par contre, surtout quand il vient d’Amérique du Sud où il est cultivé sur des sols d’origine volcanique, fertiles mais naturellement enrichis en cadmium, en accumule un peu plus, dans toute la plante, et notamment dans les fèves [comme le souligne UFC Que Choisir dans une étude publiée le 21 août dernier, NDLR]. Pas que du cadmium d’ailleurs, il peut y avoir du nickel, du chrome et d’autres métaux.
LTM : L’association de médecins libéraux évoque une forte augmentation de l’exposition au cadmium de la population, comment l’expliquez-vous ?
TS : Il y aurait eu un doublement de l’imprégnation au cadmium entre 2006 et 2014-2016. C’est ce que disent les médecins et les enquêtes. Je ne me l’explique pas parce que si la cause est alimentaire, soit les gens se sont mis à manger deux fois plus de céréales, de pommes de terre, de chocolat, de mollusques entre les deux enquêtes — ce qui paraît improbable —, soit la teneur en cadmium a doublé dans les aliments, et je ne vois pas pourquoi, sachant que les teneurs dans les sols français sont restées les mêmes et que les pratiques agricoles n’ont pas changé. Je pense qu’il n’est donc pas possible d’attribuer cette hausse à l’alimentation, aux sols ou aux engrais. Peut-être qu’une autre source de contamination au cadmium est apparue, dont on n’aurait pas connaissance. J’ai lu qu’une étude, Albane [pour Alimentation, biosurveillance, santé, nutrition et environnement, NDLR], a été lancée le 10 juin [par l’Anses et SPF, NDLR], notamment sur l’alimentation et le cadmium, peut-être apportera-t-elle une réponse à cette question.
LTM : Avec 48 % de cadmium en moins dans les aliments bio, l’Agriculture Biologique ferait mieux que le conventionnel…
TS : Les médecins se basent sur une méta-analyse de 2014, qui montre que bio est moins contaminé que le conventionnel. C’est possible. L’étude est ancienne et il n’y a pas beaucoup de données françaises ceci dit. Le bio a un avantage, à mon avis, c’est qu’il utilise moins de phosphate [des engrais phosphatés sont autorisés en agriculture biologique, et cela dépend des sols : le chocolat bio sud-américain est plutôt plus riche en cadmium que le conventionnel africain, par exemple, NDLR]. Les agriculteurs mettent moins de cadmium mais, surtout, ils enrichissent leurs sols en matières organiques. Or, l’humus retient le cadmium.
LTM : De quelle manière ?
TS : Le cadmium dans le sol, c’est un ion CD2 +, chargé positivement. L’humus est composé de molécules organiques issues de la décomposition de matières végétales, de compost, de fumier, d’engrais organiques, transformées par la microflore du sol : elles sont chargées négativement. Plus vous en ajoutez, plus vous avez tendance à favoriser le “collage électrostatique” du cadmium sur l’humus du sol. Cela limite son passage dans la solution du sol, et donc son absorption par les racines des plantes. Comme les agriculteurs apportent beaucoup de matière organique en bio, surtout en maraîchage, la migration du cadmium vers les plantes est moindre. Je ne sais pas si c’est si vrai pour les céréales, en grandes cultures, sachant que l’on dispose de fumier et autres amendements organiques en quantités limitées. Ce sujet mériterait d’être étudié. Cela étant, s’ils arrêtent d’en apporter, l’humus se dégrade chaque année en libérant les éléments qu’il contient, dont le cadmium. Mais, en bio, les agriculteurs ont tendance à maintenir ce stock parce qu’il s’agit de leur fertilisant principal. Reste qu’ils héritent souvent de parcelles longtemps cultivées en conventionnel et donc d’un stock de cadmium.
Lire : Recherche variétale : vers des blés agroécologiques
LTM : Existe-t-il d’autres pistes pour préserver la santé des consommateurs ?
TS : J’avais calculé que si l’on continue avec la réglementation française sur les engrais phosphatés, la teneur en cadmium aurait tendance à augmenter à l’échelle d’un siècle de 3 à 5 %. Tandis que si on appliquait la réglementation européenne telle que proposée en 2018 [limiter cette teneur à 60 mg/kg de pentoxyde de phosphore pendant trois ans à partir de sa promulgation, puis à 40 mg/kg pendant les neuf années suivantes, avant de passer définitivement à 20 mg/kg, valeur recommandée par les URPS, NDLR], la teneur aurait tendance à baisser de 3 à 5 %. Le problème ne sera donc pas résolu à court ou moyen termes. On peut essayer de réduire cette part de cadmium dans les sols en en apportant moins, en faisant attention à la teneur de la parcelle sur laquelle on cultive les céréales, en veillant à ajouter de la matière organique et à empêcher les sols de s’acidifier — parce que le cadmium, comme à peu près tous les éléments, est plus soluble sur sol acide. Même si, en France, les sols ne sont pas très acides, plutôt calcaires. Mais, ce qui me paraît être la voie la plus efficace, ce serait d’utiliser des variétés qui l’accumulent moins : que les sélectionneurs de variétés de blé ou de pomme de terre — principales cultures exposant au cadmium — se penchent sur son accumulation par la plante comme critère de sélection variétale.
* Cadmium : enquête sur ce poison insoupçonné dans nos assiettes. Zone interdite, janvier 2025.
** Voir l’interview vidéo de Laure Verdeau sur le compte Instagram @latoquemagazine.




